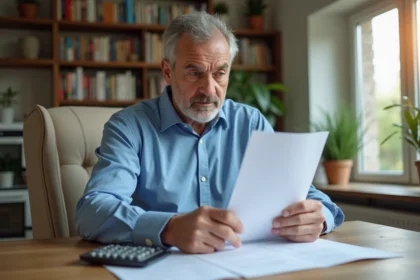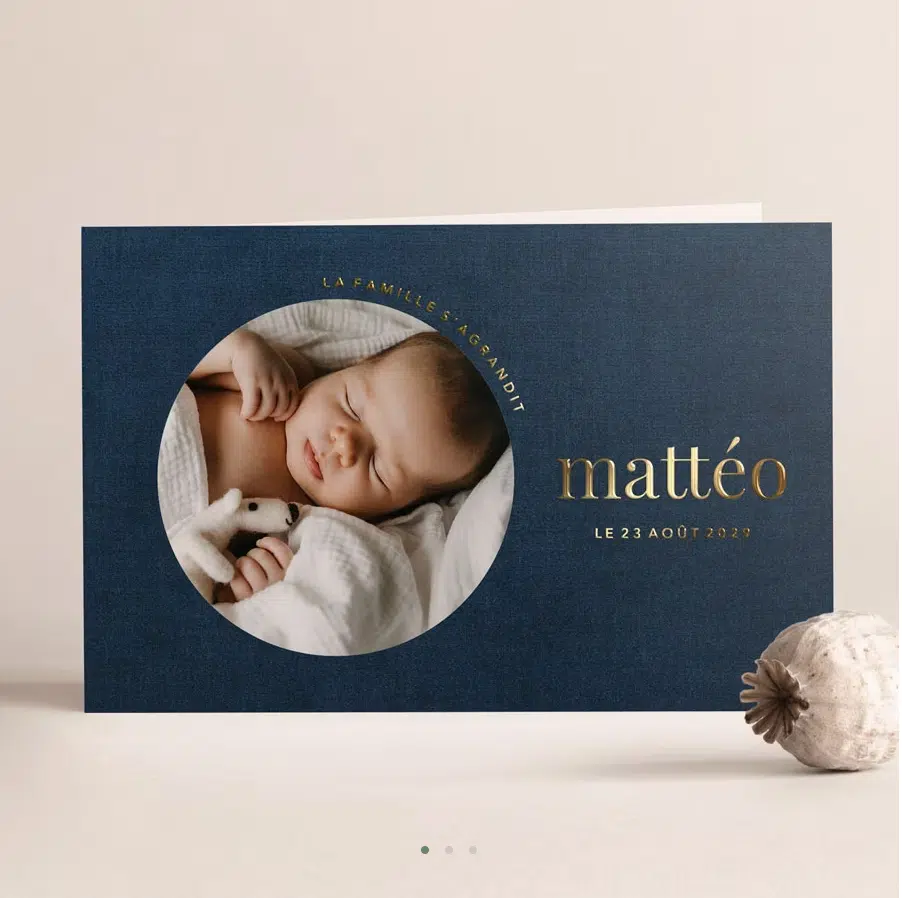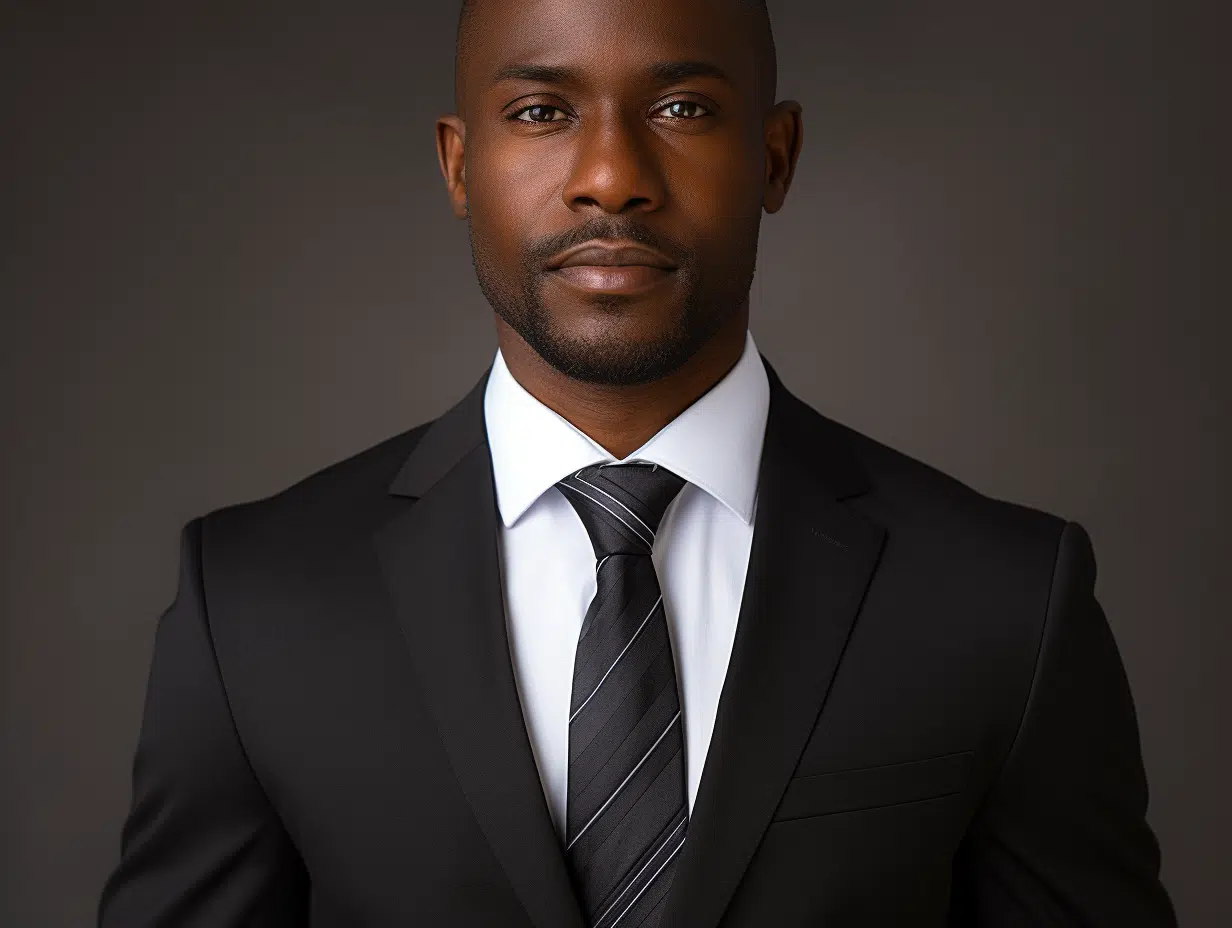Imposer une couleur, un tissu ou une coupe selon qu’on soit né garçon ou fille : voilà le legs discret mais bien réel de plusieurs siècles de diktats vestimentaires. Dès l’enfance, la garde-robe balise la trajectoire sociale, assignant rôles et attentes, comme si le choix d’une chemise ou d’une jupe révélait déjà toute une vision du monde. Depuis le XVIIIe siècle, les codes vestimentaires imposent des standards différents selon le genre, façonnant l’accès à certains vêtements et dictant leur légitimité sociale. Les études en sociologie confirment que les comportements d’achat et d’appropriation de la mode varient fortement selon l’appartenance de genre.
L’essor des collections unisexes et la remise en cause des stéréotypes vestimentaires tendent à complexifier la répartition traditionnelle des rôles. Pourtant, la pression normative et les attentes sociales continuent de peser aussi, révélant des disparités persistantes dans la manière dont la mode structure l’identité de chacun.
La mode, miroir des identités sociales et de genre
La mode ne se contente pas de jouer sur les apparences. Elle s’infiltre partout : dans la construction de l’identité de genre, dans les appartenances sociales, jusque dans l’intégration à certains groupes. Regardez les travaux de Pierre Bourdieu ou de Roland Barthes : pour eux, le vêtement, loin d’être quelconque, fonctionne comme un langage social à part entière. Il classe, segmente, distingue. À Paris, capitale autoproclamée du style, ce phénomène s’observe à chaque coin de rue : la tenue devient presque un manifeste, une manière de se démarquer.
Les sociologues, de Georg Simmel à Michel Pastoureau, décortiquent la mode comme le reflet des tensions entre la tentation d’imiter et l’envie de se singulariser. S’habiller, c’est choisir son camp, afficher ses préférences, signaler un groupe d’appartenance ou, au contraire, marquer son indépendance. La coupe d’un blazer, la matière d’un manteau, le logo d’un sac à main : tout cela dit quelque chose de la position sociale de celui ou celle qui le porte.
Les pratiques vestimentaires ne se contentent pas de refléter la société : elles la renforcent, elles la structurent, elles distribuent les rôles et les pouvoirs. La mode, en France comme ailleurs en Europe, rappelle que le corps n’est jamais neutre dans la construction de l’identité sociale. À travers l’histoire, le vêtement a fonctionné tantôt comme une barrière, tantôt comme un passeport, accompagnant l’évolution des normes de genre, des hiérarchies sociales, des mentalités collectives.
La mode, loin d’être un simple décor, grossit les traits des évolutions ou des résistances qui traversent la société. Les identités de genre, toujours en mouvement, trouvent dans les vêtements un terrain d’essai, un espace de revendication, parfois même un champ de bataille symbolique.
Qui accorde le plus d’importance à la mode : question de sexe ou de société ?
Les enquêtes sur la sociologie de la mode révèlent une réalité bien plus nuancée qu’on ne le croit souvent. La mode n’est pas réservée aux femmes, malgré un discours médiatique et industriel qui continue d’associer l’attention portée aux vêtements féminins à la futilité ou à l’excès d’apparence. Nicolas Herpin l’a montré : l’intérêt pour la mode traverse tous les genres, mais il prend des formes différentes selon les milieux sociaux et les générations.
Chez les jeunes, le vêtement devient un outil d’intégration, un marqueur d’appartenance, voire un moyen d’affirmer sa place dans le groupe. Certains jeunes hommes issus des classes moyennes supérieures cultivent un sens du détail, un goût pour les marques ou l’originalité qui rivalise parfois avec celui de leurs homologues féminines. Des chercheurs comme Muriel Darmon et Gérard Mauger mettent en évidence que la distinction par le vêtement concerne tout le monde, même si les codes et les moyens varient selon la position sociale.
Dans les classes populaires, l’écart entre les genres se creuse : la mode reste davantage associée à la féminité. Les hommes issus de ces milieux affichent moins d’intérêt pour les tendances, mais accordent de la valeur à la propreté, à la sobriété, à une certaine respectabilité. Martine Court, Aurélia Mardon ou Isabelle Clair l’ont observé : ici, le vêtement se fait gage de sérieux et de moralité, bien plus qu’expression d’une individualité ou d’un style personnel.
Voici quelques repères pour mieux cerner cette diversité des rapports à la mode :
- Genre et classe sociale structurent de façon déterminante le rapport à la mode, au-delà des clichés habituels.
- Femmes, hommes, jeunes : tous puisent dans la mode des moyens de se forger une image, de s’insérer dans un groupe, de se distinguer.
L’émergence de la mode unisexe face aux stéréotypes et à l’hypersexualisation
La mode unisexe bouscule les repères, efface les anciennes frontières entre masculin et féminin. Face à la pression persistante des stéréotypes et à l’hypersexualisation, qui s’imposent aussi bien dans la fast fashion que sur les podiums, de plus en plus de créateurs cherchent de nouveaux chemins. Sur les réseaux sociaux, des personnalités comme Mark Bryan, ingénieur allemand arborant jupe et talons, pulvérisent les codes de genre. L’héritage de Madeleine Pelletier, qui militait pour le droit au pantalon, réapparaît aujourd’hui dans des silhouettes où le tailleur côtoie le boyfriend jeans et où la mini-jupe se porte sans étiquette figée.
La diversité des morphologies et des identités s’exprime désormais sans entrave, portée notamment par les plus jeunes. Les fashion weeks de Paris ou Londres voient défiler des looks où chaque vêtement devient revendication. Les marques issues de milieux favorisés surfent sur cette vague, tandis que la mode de seconde main explose, libérant la créativité loin des contraintes du marketing genré.
Pour mieux comprendre ce bouleversement, retenons ces éléments-clés :
- Le vêtement unisexe fonctionne comme un outil de contestation, une manière de répondre à l’injonction de conformité.
- La fast fashion et les réseaux sociaux accélèrent la circulation de ces nouveaux codes hybrides, tout en véhiculant parfois d’autres stéréotypes, plus discrets mais tout aussi tenaces.
La mode féminine change de cap, la mode masculine s’affranchit. Les repères s’estompent, les accessoires se réinventent. Cette dynamique questionne la place du corps, du regard d’autrui, et la répartition du pouvoir dans la société actuelle.
Quand les vêtements redéfinissent notre perception du genre
Le lien entre vêtements et genre traverse toute l’histoire sociale, de la Révolution française aux podiums londoniens, en passant par les salons aristocratiques. Porter un pantalon ou une robe : jamais anodin. À Paris, le pantalon fut longtemps interdit aux femmes. Au XIXe siècle, il incarne l’émancipation, porté par Amélia Bloomer, George Sand ou Rosa Bonheur. À l’inverse, la robe portée par des hommes, du chevalier d’Éon à David Bowie, vient interroger la définition même de la masculinité.
De nos jours, la mode s’empare pleinement de cette ambiguïté. Maquillage, talons, jupes, chemises oversize : autant de signes d’une identité en mouvement, d’une envie d’explorer de nouveaux territoires. Des artistes comme Harry Styles ou Billie Eilish brouillent les pistes, s’affranchissant des codes binaires. Des œuvres comme la série Sexe Education ou le film Laurence Anyways mettent en lumière la pluralité des identités de genre et d’orientations sexuelles.
Pour saisir l’impact social de ces évolutions, voici deux points de repère :
- Les pratiques vestimentaires servent de terrain d’expression aux identités de genre, mais aussi aux revendications politiques ou sociales.
- En France comme au Royaume-Uni, ces évolutions sont frappantes : du procès de Jeanne d’Arc pour port de vêtements masculins jusqu’aux défilés où la jupe masculine devient déclaration.
Le vêtement ne se contente plus d’habiller le corps : il devient instrument de liberté, outil de subversion, révélant toute la richesse des identités, bien loin des catégories figées. Reste à savoir si la société saura suivre le rythme ou se contentera de regarder passer la vague, fascinée et un peu déstabilisée.